Étude expérimentale et analytique d’assemblages mono-boulonnés avec différents jeux de perçages et boulons M8 à M14
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 4
Aucun résultat n'a été trouvé
En attente de recherche
Veuillez cliquer sur l'icône ou appuyer sur pour valider votre recherche.
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 4
Type article : Techniques et Applications
Parution : 2025 numero 4
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 4
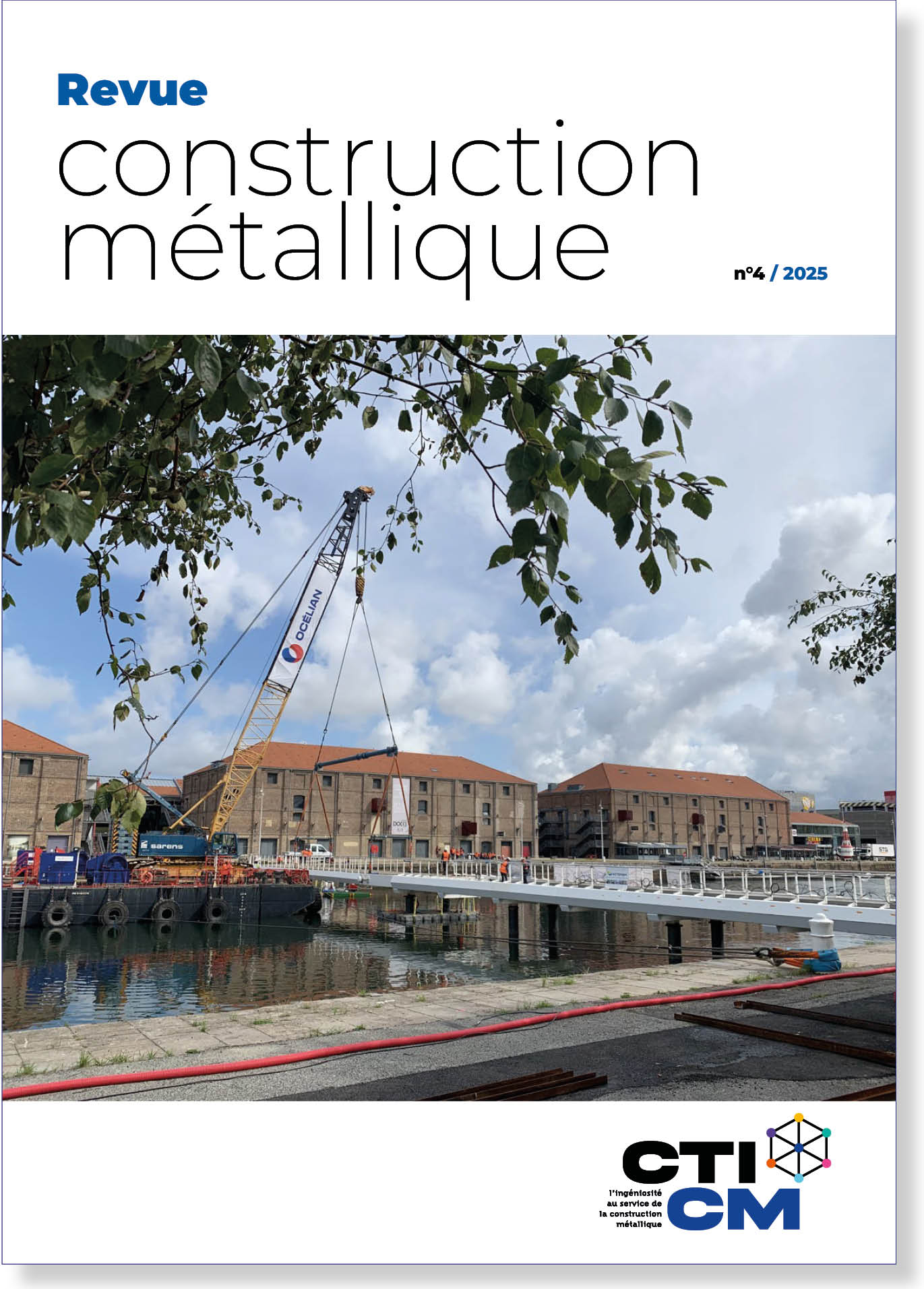
Parution : 2025 numero 3
Sommaire :
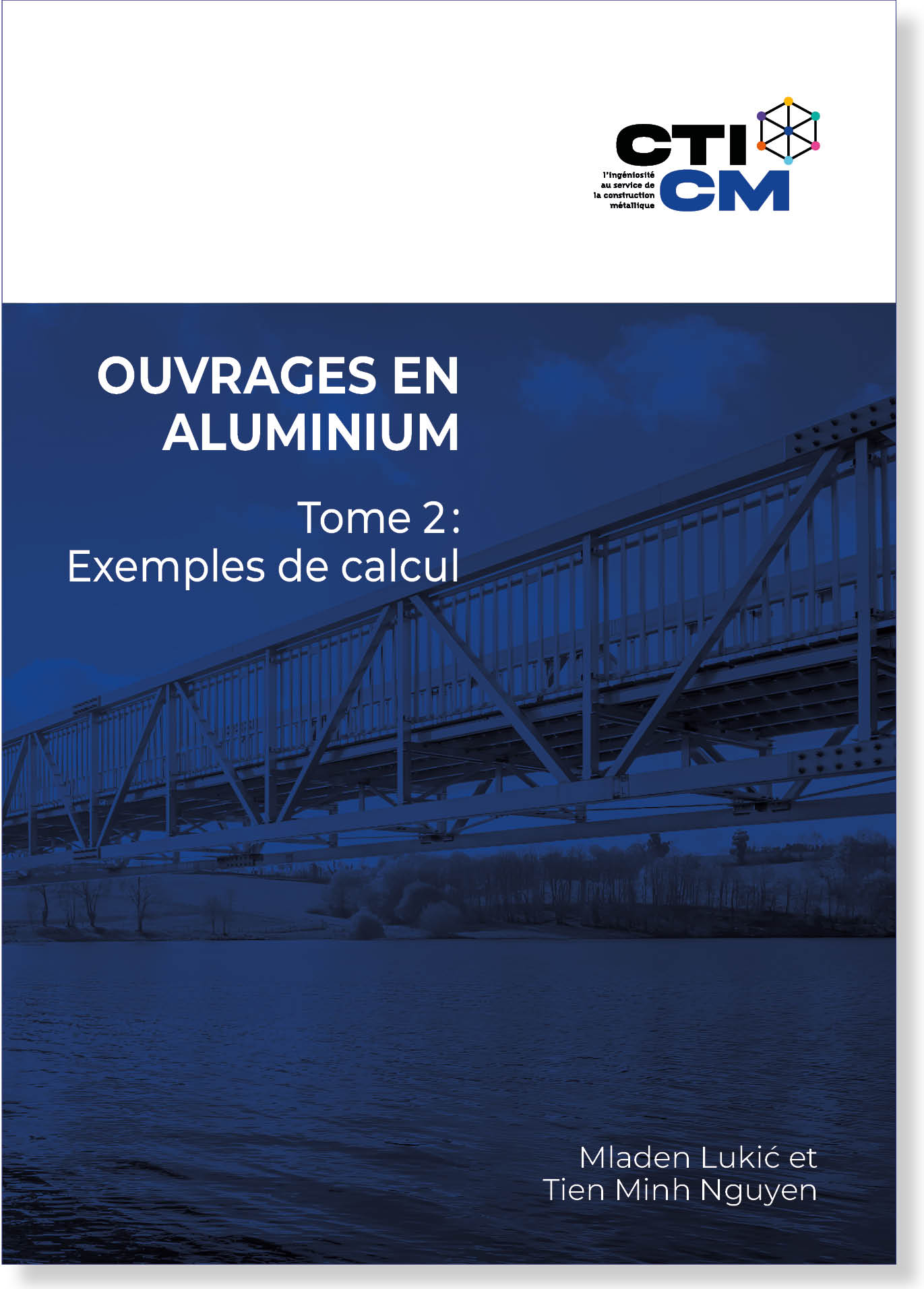
Parution : 2025
Auteur(s) : Lukic M., Nguyen T.M.
Ce deuxième tome contient des exemples d’application permettant de comprendre des méthodes de calcul qui sont présentées dans le premier tome. Un ouvrage de référence en français, adapté aux besoins actuels des professionnels de la construction métallique.

Au sommaire:
Actualités
Actualité sur la réglementation et les normes parasismiques
Construire sa démarche RSE : une opportunité pour toute la filière métallique
Eiffel de l’architecture 2025 : la création métallique à l’honneur
Filière acier : l’amont et l’aval font front commun pour la souveraineté
Dossier : Révision des Eurocodes Parties incendie
Rencontre: Patrick Carret, directeur de la Fédération nationale des écoles de production
Sur le terrain: Passerelle coulissante au Havre (14)
Assistance technique
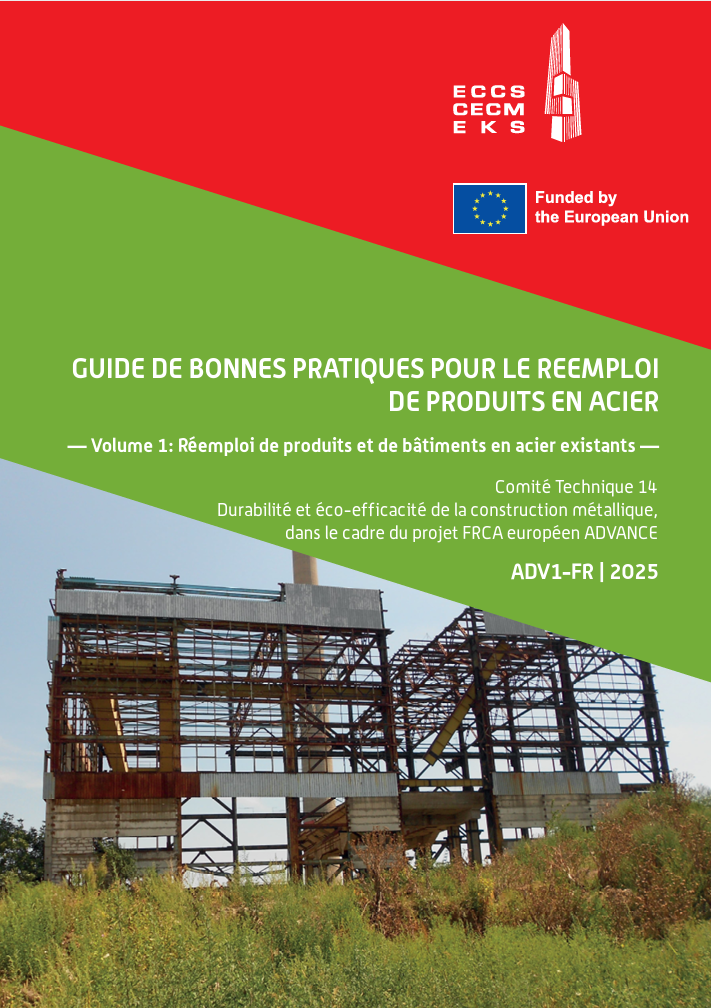
Parution : 2025
Ce guide traite des questions techniques générales liées à l’utilisation structurale de l’acier récupéré dans les structures existantes en acier et les structures mixtes acier-béton.
Il présente une brève description de l’anatomie des bâtiments à un ou plusieurs étages, la classification des différents scénarios de réemploi, une bibliographie des guides de bonnes pratiques européens et des normes produit, des critères de sélection et d’acceptation des produits, et leur classification pour les « nouvelles » conceptions conformément aux Eurocodes.
Il aborde également les aspects de la conception selon les principes des états limites. Le protocole d’évaluation qualitative des éléments, d’échantillonnage et d’essai de l’acier récupéré figure dans l’annexe A. L’estimation du coefficient partiel modifié pour la résistance au flambement des éléments en acier réemployés est présentée à l’annexe B.
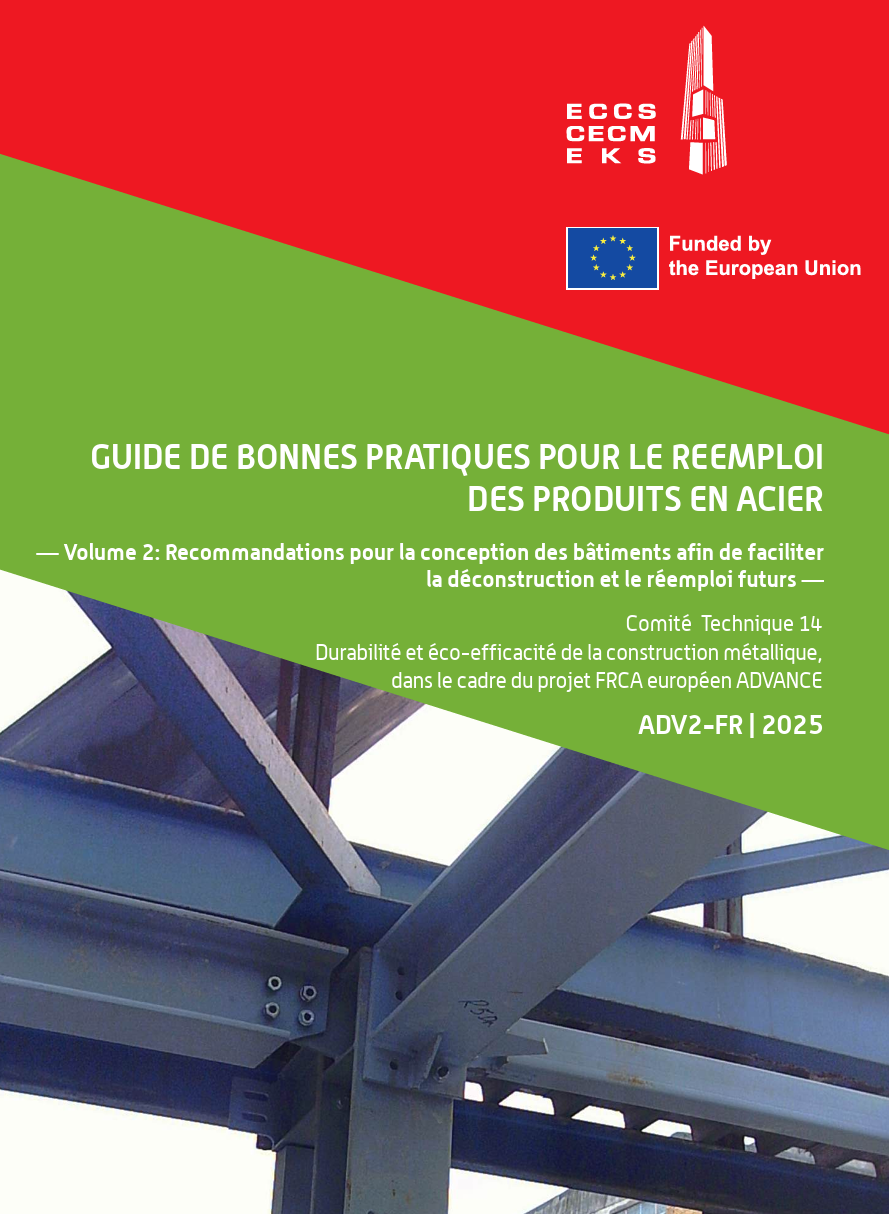
Parution : 2025
Ce guide couvre la conception de nouveaux bâtiments avec des objectifs de fonctionnalité, de facilité de fabrication, de démontabilité, de réemploi futur, ainsi que d’esthétique.
Il donne les principes généraux de conception dans l’objectif de faciliter le démontage et le réemploi d’une charpente métallique.
Il définit, également, les charges et les combinaisons d’actions à utiliser dans le dimensionnement et propose des améliorations générales dans les détails de construction qui facilitent le réemploi futur.

Au sommaire:
Actualités
Actualité logiciel
Les rencontres métalliques de l’Ouest
La MCM au rendez-vous de la construction bas carbone et circulaire
ADDENDUM – Bocad, un oubli à corriger
Dossier : Le CTICM, pilier d’une construction métallique en mutation
Rencontre
Lionel Matias, à la tête d’A2M Proximétal et de l’UIMM
Sur le terrain
Extension de l’École 42 (75)
Formation
La formation continue au CTICM
Assistance technique
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 3
Auteur(s) : Bihina G., Thauvoye C.
Type article : Techniques et Applications
Parution : 2025 numero 3
Auteur(s) : Martin P.O., Rodier A., Phan C. V.
Contexte et domaine d’application
Dans la norme NF EN 1994-1-1 [4], le terme d’assemblage mixte désigne l’encastrement de l’extrémité d’une poutre mixte avec un poteau, dans laquelle l’armature de la dalle reprend une partie des efforts de traction engendrés dans l’attache. La norme ne prévoit pas d’assemblage mixte en zone de moment positif, pour lequel une contribution de la dalle en compression pourrait être prise en compte.
Pour les assemblages mixtes entre une poutre et un poteau, il est nécessaire d’envisager la présence d’un moment positif quand le système structural est stabilisé par effet portique et est soumis à des actions latérales. Ce point n’étant pas abordé par la norme, plusieurs publications traitent de ce sujet, par exemple [8] ou [9].
Un assemblage mixte en zone de moment positif peut aussi être nécessaire pour réaliser la continuité d’une poutre mixte. C’est typiquement le cas pour une poutre mixte de grande portée, quand des limites d’accès ou de levage imposent une livraison du profilé dans une longueur inférieure à celle de la portée. Un assemblage en zone de moment positif doit alors être conçu, par exemple à mi-portée de la poutre.
Pour pallier l’absence d’indications dans la NF EN 1994-1-1, cet article propose un modèle de calcul pour des assemblages de continuité par platines d’about de poutres mixtes sous moment positif, basé sur la méthode des composants de la norme NF EN 1993-1-8 [3], adaptée pour tenir compte de la présence de la dalle comprimée. Il reprend aussi les concepts de calcul des poutres mixtes de la NF EN 1994-1-1 et permet, en particulier, de prendre en compte une connexion partielle. La première partie est consacrée au calcul de la résistance en flexion, elle est accompagnée d’un exemple d’application. Une seconde partie, à paraître ultérieurement, traitera de la rigidité d’un tel assemblage mixte.
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 3
Auteur(s) : Heng P., Zhao B.
RÉSUMÉ
Cet article présente le développement d’un nouvel élément fini de poutre 3D pour l’analyse non linéaire des structures en acier et des structures mixtes acier-béton soumises à l’incendie. Le modèle adopte une formulation co-rotationnelle pour le calcul du vecteur des forces internes et de la matrice de rigidité associée, permettant de traiter efficacement le phénomène de grand déplacement. Chaque nœud est doté de sept degrés de liberté afin de prendre en compte les effets de gauchissement de la section transversale d’une barre. La discrétisation des sections transversales repose sur une approche multifibre, autorisant la modélisation de sections transversales de forme arbitraire et une représentation précise des distributions de température non uniformes (pour le calcul au feu) ainsi que des états de contrainte triaxiaux induits par la torsion, les efforts axiaux et les moments fléchissants.
Le comportement thermomécanique est modélisé à l’aide de lois con-stitutives élasto-plastiques tridimensionnelles intégrant les propriétés des matériaux dépendantes de la température, conformément aux prescriptions de l’Eurocode. Le comportement de l’acier est traité par une projection en contraintes planes, tandis qu’une stratégie de condensa-tion est appliquée au comportement du béton.
Afin de pouvoir obtenir un état avancé de la déformée d’une structure à l’état limite ou une résolution numérique en cas d’instabilité locale précoce, une approche spécifique basée sur la résolution dynamique a été introduite. Cette résolution du comportement dynamique non linéaire repose sur une méthode implicite, basée sur le schéma de Newmark. En présence de rotations finies, les équations de Newmark sont formulées en fonction du vecteur de rotation incrémental et de sa dérivée temporelle. Afin d’éviter la complexité des termes dynamiques induite par la décomposition en mouvement rigide et déformation propre dans le cadre co-rotationnel, une formulation lagrangienne totale est adoptée pour l’expression des termes dynamiques.
La validation du modèle à partir d’exemples numériques de référence démontre à la fois la robustesse et la précision de la formulation dynamique dans la prédiction du comportement thermomécanique des structures. Elle permet notamment de reproduire fidèlement les modes de ruine tout en assurant une stabilité numérique supérieure à celle obtenue avec une approche statique. Cette approche offre ainsi une évaluation plus complète du comportement structural en situation d’incendie.
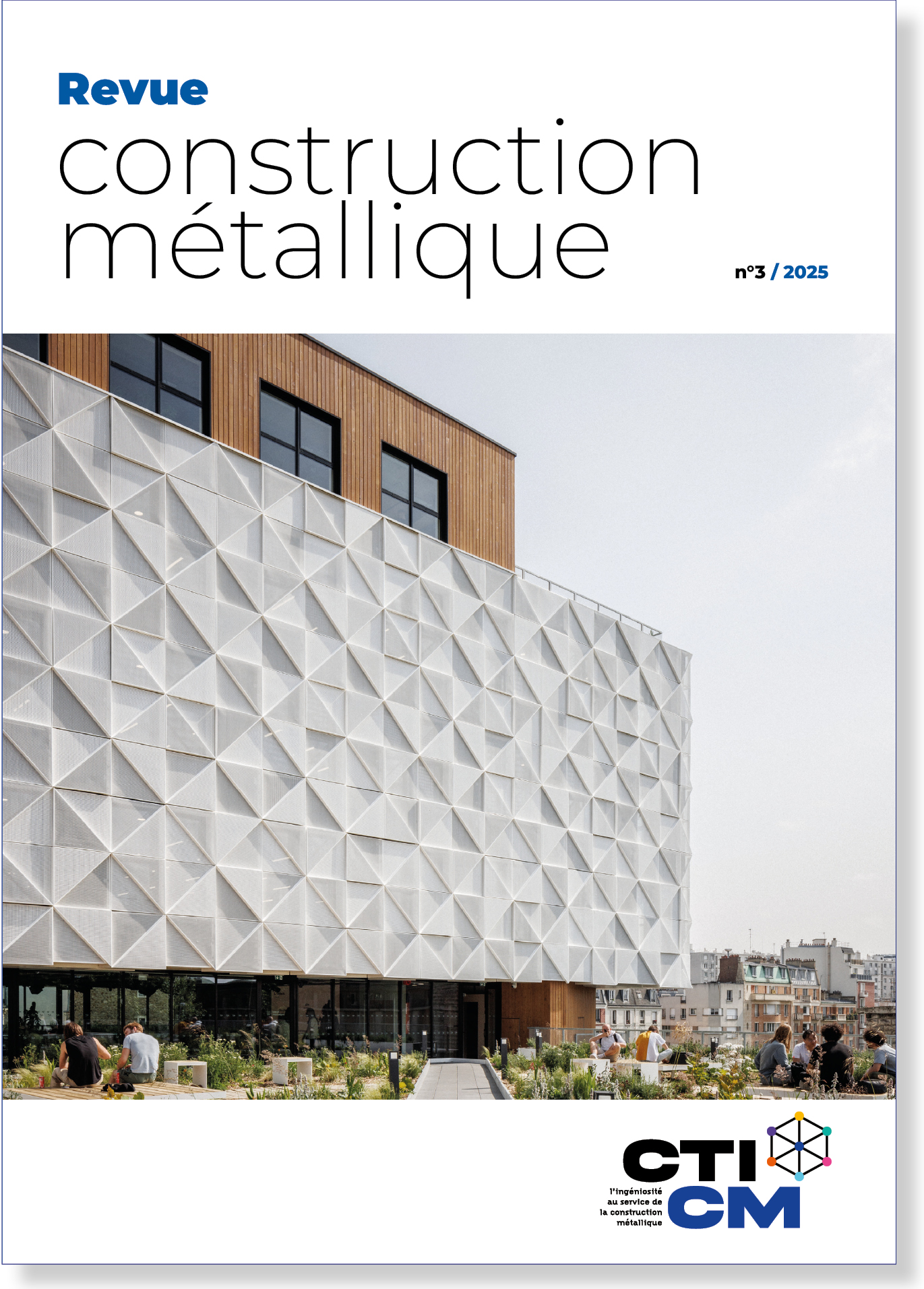
Parution : 2025 numero 3
Sommaire :
Référence : FDES CTICM version de janvier 2025 1.2
Projet : FDES produits acier - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire
Référence : FDES CTICM version de janvier 2025 1.2
Projet : FDES produits acier - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire
Référence : FDES CTICM version de janvier 2025 1.2
Projet : FDES produits acier - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire
Référence : FDES CTICM version de janvier 2025 1.2
Projet : FDES produits acier - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire
Référence : FDES CTICM version de janvier 2025 1.2
Projet : FDES produits acier - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire
Référence : FDES CTICM version de janvier 2025 1.2
Projet : FDES produits acier - Fiches de déclaration environnementale et sanitaire

Au sommaire:
Actualités
Actualités logiciels du CTICM, évolutions et nouveaux développements
Aluminium : un guide de référence pour les structures du bâtiment
Se former à la RE2020, un impératif stratégique pour les constructeurs métalliques
Construire en métal face aux nouveaux défi s : une matinée pour s’informer, échanger et agir
Recherche FISHWALL, présentation des résultats
Jean-Claude Fayat prend la tête de la Fédération des industries mécaniques
Dossier : Les logiciels pour la construction métallique
Rencontre
Maxime et Julie Turetta, à la tête de CMD
Sur le terrain
Le BEM de Paris-Saclay (91)
Assistance technique
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 2
Auteur(s) : Mouradian K., Lukic M., Couchaux M., Beyer A.
Les assemblages soudés jouent un rôle majeur dans l’intégrité et la durabilité des structures en acier. Toutefois, ces assemblages soudés sont susceptibles de présenter des défauts dus à la fabrication qui peuvent affecter leur résistance à la fatigue. En conséquence, le prEN 1993-1-9 fait référence au niveau de qualité de soudure B défini dans l’ISO 5817 pour garantir une résistance à la fatigue adéquate. Cependant, il n’existe pas d’études approfondies justifiant cette exigence. Le présent article
analyse à la fois les essais expérimentaux cités dans le document background du prEN 1993-1-9 et les essais récents afin d’obtenir des courbes de résistance à la fatigue. Les soudures bout à bout à pleine pénétration ou par cordons d’angle sont étudiées. Certains essais comportaient des défauts mesurés qui ont permis d’analyser leur impact sur la résistance à la fatigue. En outre, une comparaison est effectuée entre les résultats expérimentaux et les conclusions fournies par la norme XP ISO/ TS 20273 et les recommandations de l’IIW, qui établissent un lien entre défauts des soudures et résistance à la fatigue. Les spécifications de la XP ISO/TS 20273 ne sont pas toujours en accord avec les résultats expérimentaux. Les défauts tels que le manque de pénétration, le défaut d’alignement, les caniveaux et le mauvais assemblage en soudure d’angle ont été analysés. Les résultats ont révélé qu’un manque de pénétration correspondant au niveau de qualité D entraînait une diminution de 40% de la résistance à la fatigue des soudures bout à bout, contre une réduction de 20 % due à un défaut d’alignement du même niveau de qualité. Dans les assemblages par cordons d’angle, un défaut d’alignement de qualité D réduisait la résistance à la fatigue de 23 %, tandis qu’un mauvais assemblage au même niveau augmentait la résistance à la fatigue de 16 %. Les résultats révèlent que les niveaux de qualité ne sont pas toujours en corrélation avec les catégories de détail (résistance à la fatigue) indiquées dans le prEN 1993-1-9.
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 2
Auteur(s) : Nguyen T.M., Lukic M.
Type article : Article de Recherche
Parution : 2025 numero 2
Auteur(s) : Sarou L., Couchaux M., Hjiaj M., Sire S.
Contexte et objet de l’article
Le comportement d’un assemblage soumis à un moment fléchissant peut être modélisé à l’aide d’un ressort flexionnel qui permet de relier le moment fléchissant à la rotation de l’assemblage. Un assemblage peut ainsi être caractérisé par trois paramètres : sa rigidité initiale en rotation, son moment résistant et sa capacité de rotation. La rigidité initiale en rotation d’un assemblage caractérise sa réponse dans le domaine élastique. Ce paramètre peut fortement impacter le comportement global de la structure complète. La rigidité initiale en rotation dépend des propriétés mécaniques des composants de base qui constituent l’assemblage. Pour modéliser le comportement flexionnel d’un assemblage, l’Eurocode 3 Partie 1-8 s’appuie sur la méthode des composants. Un assemblage est divisé en un ensemble d’éléments de base, les composants, reliés entre eux par des éléments rigides. Chaque composant est représenté par un ressort auquel est associé un coefficient
de rigidité élastique ki. L’assemblage de ces composants permet d’évaluer les caractéristiques mécaniques de l’assemblage et plus particulièrement la rigidité initiale en rotation.
Pour lire la suite, téléchargez le document
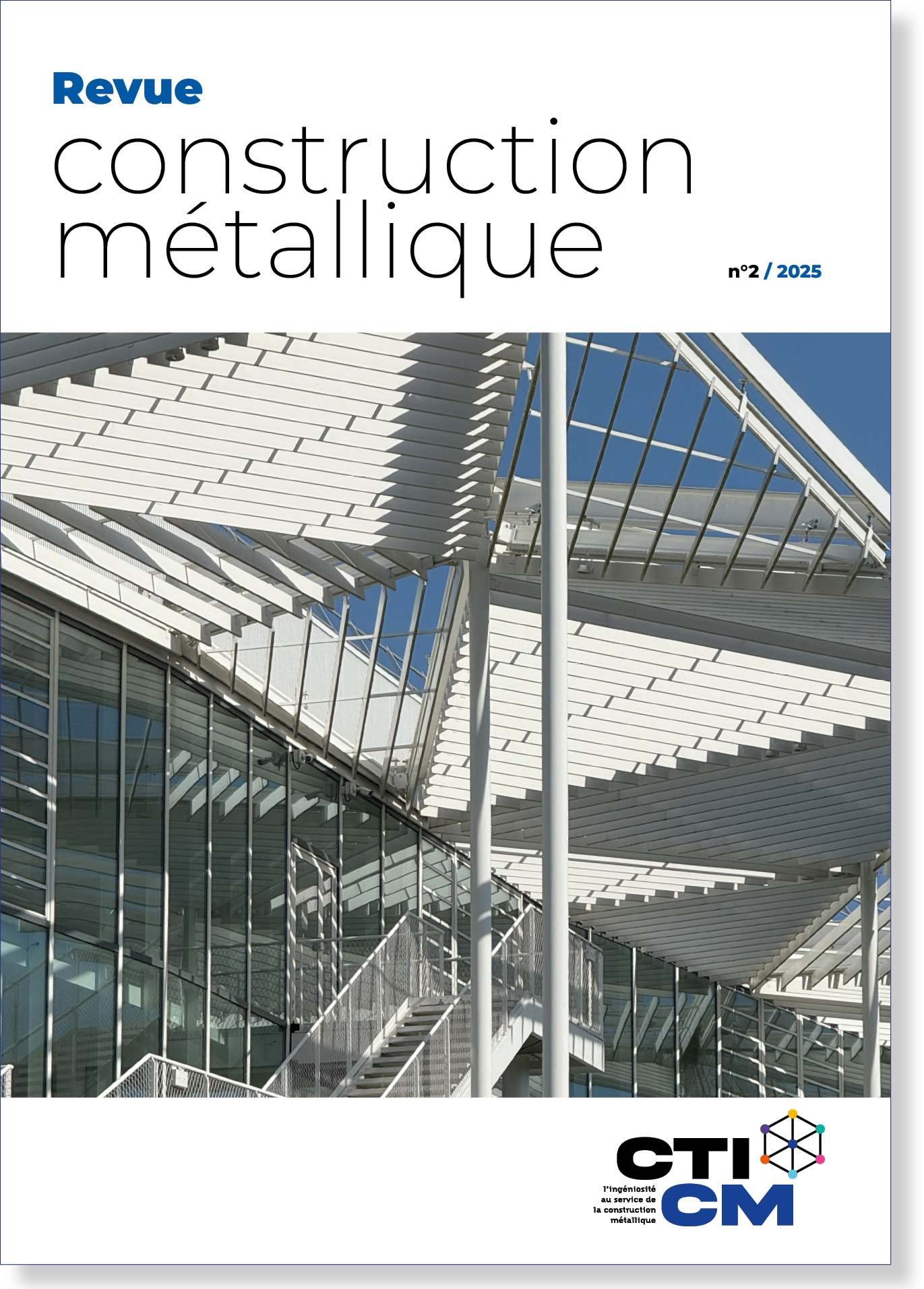
Parution : 2025 numero 2
Sommaire :
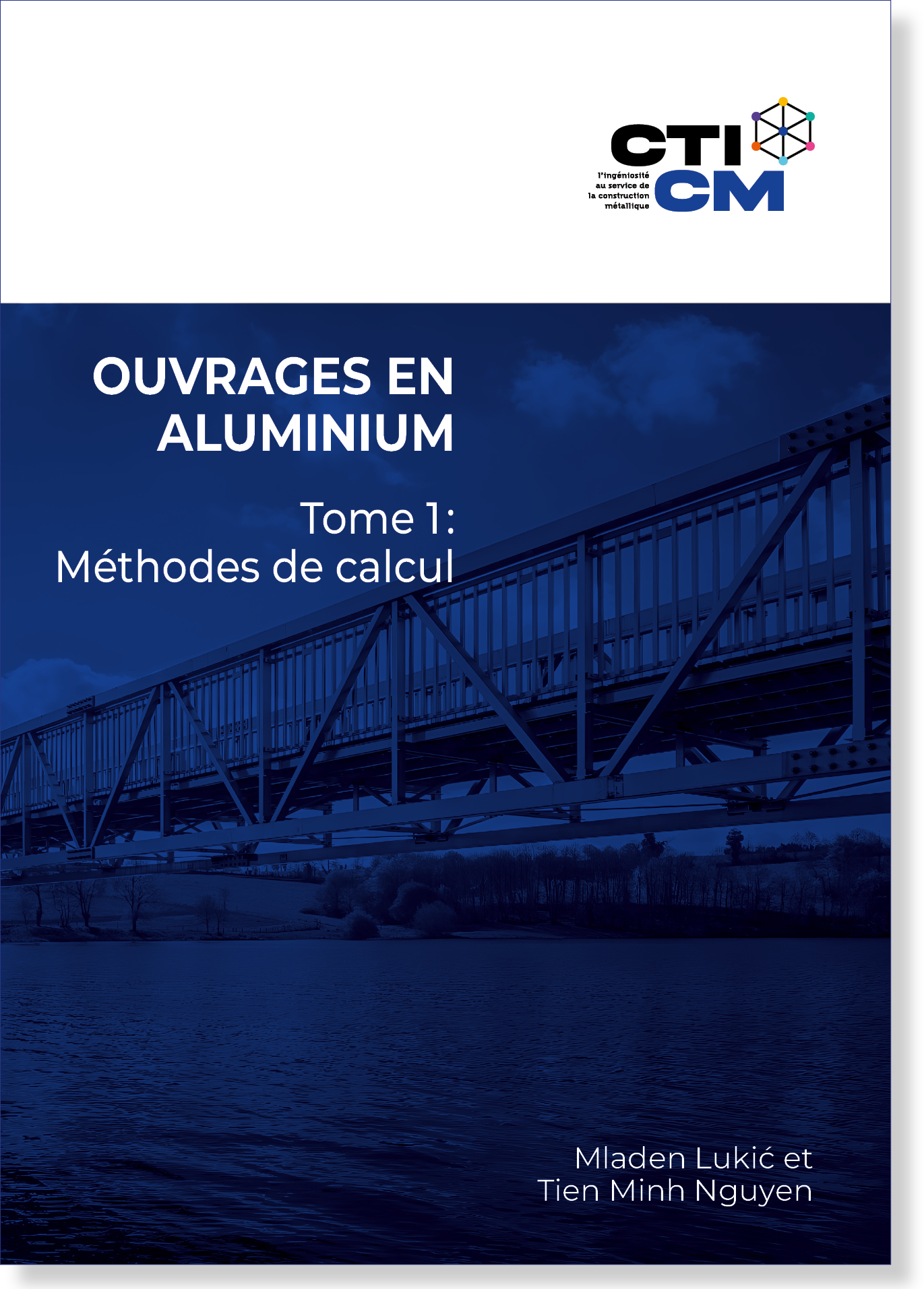
Parution : 2025
Auteur(s) : Lukic M., Nguyen T.M.
La construction en aluminium, portée par la légèreté, la durabilité et la polyvalence de ce matériau, occupe une place certaine dans le secteur du bâtiment. Depuis l’introduction de l’Eurocode 9, la conception des structures en alliages d’aluminium s’appuie sur des règles européennes. Pourtant, les références actuelles restent peu nombreuses, souvent disparates, et difficilement accessibles aux praticiens francophones.
Cet ouvrage propose une réponse simple et structurée à ce constat. Conçu comme un guide pratique, il rassemble les fondamentaux de la conception et du calcul d’éléments en aluminium pour le bâtiment, selon l’Eurocode 9. On y trouvera des recommandations claires, illustrées d’exemples de calcul concrets, ainsi que des bonnes pratiques à l’usage des bureaux d’études, des entreprises et des étudiants du secteur.
Ce premier tome constitue une base fiable pour comprendre le comportement de l’aluminium dans les structures, anticiper ses particularités et exploiter pleinement le potentiel de ce matériau. Un ouvrage de référence en français, adapté aux besoins actuels des professionnels de la construction métallique.
Converser maintenant avec Gustave, votre assistant technique virtuel (IA).
Vous devez être connecté pour utiliser le chat Bot.
Gustave, notre chat bot IA, est une intelligence artificielle mise en place par le CTICM et entraînée par nos experts pendant plusieurs mois. Cet outil est conçu pour aider à répondre aux questions concernant la conception et la construction métallique. Les informations fournies le sont à titre indicatif uniquement et ne sauraient se substituer au jugement d'un ingénieur professionnel. En utilisant Gustave, vous reconnaissez que le CTICM n'est pas responsable de décisions prises sur la base unique des réponses fournies par Gustave.
Pour obtenir des informations complètes et faisant autorité, vous pouvez approfondir votre demande auprès d'un de nos experts Allo Tech